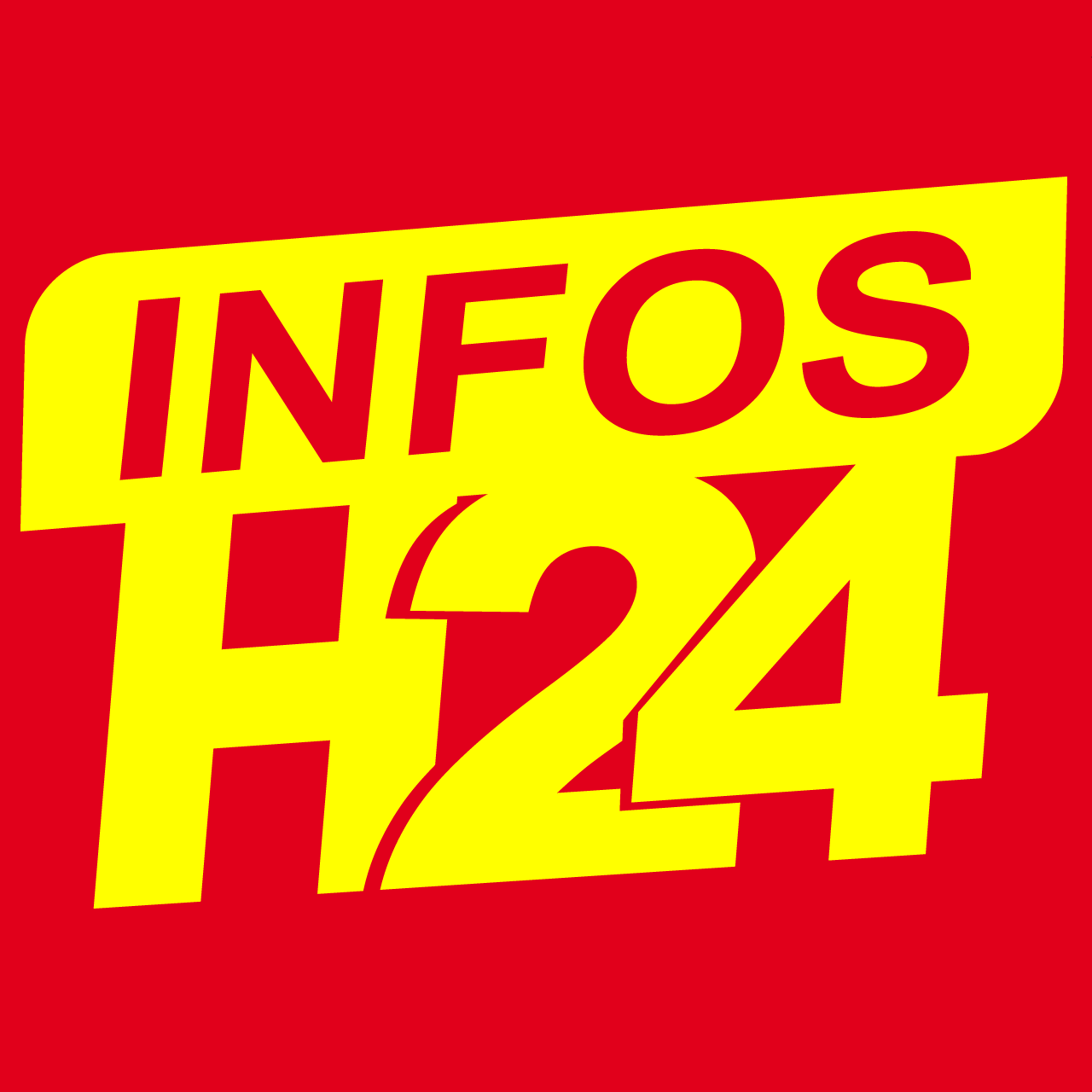HISTOIRE. Après une campagne de fouilles menée par Christian Markiewicz, archéologue spécialiste du Moyen-Âge, le Mikvé nous éclaire un peu plus sur la présence de la communauté juive à Montpellier dès le XIIe siècle. Les résultats montrent également le caractère exceptionnel du site de la rue de la Barralerie, dans l’Écusson à Montpellier, à côté de la préfecture de l’Hérault. .
Depuis 2009, Christian Markiewicz du laboratoire d’archéologie médiévale et moderne en Méditerranée de l’Université d’Aix-en-Provence, effectue des études sur le site avec l’objectif de découvrir ce qu’il subsiste de la présence de la communauté juive.
Des fouilles qui viennent en complément des études et restaurations menées depuis 1985. En présence de Philippe Saurel, il a livré les résultats des sondages du lieu, « coeur monumental et symbolique de la communauté juive » dès le 12e siècle.

Le maire de Montpellier, passionné d’histoire, a ainsi montré l’attachement qu’il avait pour l’édifice acquis par la Ville au fur et à mesure du temps « appartement par appartement, fond de commerce par fond de commerce ». Si le Mikvé revêt bien sûr une symbolique judaïque, Philippe Saurel souligne : « L’édifice appartient à la Ville. Il est trop important pour qu’il échappe au corps constitué par les Montpelliérains. Il n’a pas une vocation religieuse et n’appartient pas à une communauté ». Le Mikvé s’ancre ainsi pleinement, tout comme la communauté juive, dans l’histoire et le patrimoine de Montpellier.

Les fouilles ont permis de mettre à jour plusieurs éléments dans la crypte. Trois arcatures d’1,40 m sur 4m de haut « peuvent représenter la magnificence de l’édifice », selon Christian Markiewicz. Mais également une cuve à vin et surtout un bassin de 3m40 de diamètre justifiant à lui seul « la troisième campagne de fouilles depuis le mois de janvier pour terminer l’exploitation du site ». Aussi, l’archéologue ne cache -t-il pas son enthousiasme : « C’est l’un des plus beaux Mikvé du monde ».
Comparable à celui de Jérusalem
La présence dans un même site d’un Mikvé et d’un bassin est en effet extrêmement rare. Selon Christian Markiewicz, il n’existerait que trois Mikvé de cette période en France : à Montpellier, Strasbourg et Saint-Paul-Trois-Châteaux, dans la Drôme provençale. Et seul le site de Bat Ayin à Jérusalem serait comparable à celui de Montpellier, en raison de la présence également d’une cuve à vin.
Cette dernière expliquerait peut-être l’usage qui était fait du bassin. Car un doute subsiste encore sur son utilisation et plusieurs hypothèses sont avancées. Il pourrait s’agir d’un pédiluve utilisé avant le rituel sacré du bain, d’un bassin sanitaire dédié à l’hygiène corporelle ou à la cachérisation des objets soit il s’agirait d’un pressoir à vin.

C’est pierre après pierre que le bassin a été mis à jour confirmant ainsi la présence d’une communauté juive importante entre le XIIe et le XIVe siècle. En 1306, Philippe Le Bel ordonne l’expulsion des juifs de France et saisit leurs propriétés.
À Montpellier, l’édifice de la rue de la Barralerie est alors profondément modifié. Une décennie plus tard, « quand les juifs reviennent, de leur quartier il ne reste que le Mikvé qui était devenu un point d’eau » raconte Christian Markiewicz. Le bassin a été comblé et seule une trappe, découverte lors des fouilles, laissait deviner l’ancien usage des lieux. Ce n’est que dans les années 1980, un locataire se plaignant de l’humidité de la cave, que le Mikvé a été remis à jour et progressivement restauré.
Relevés en 3D
Cette dernière campagne de fouilles et les découvertes qui en découlent invitent selon l’archéologue « à lire le site en négatif, à se déplacer dans les caves et les sous-sols où la réalité juive respire et reprend de la lumière ». La communauté juive au XIVe siècle représentait entre 500 et 1000 personnes sur une population avoisinant les 15’000. Christian Markiewicz estime que des traces de leurs activités pourraient être retrouvées dans de nombreuses caves du centre-ville de Montpellier.
Les études touchent maintenant à leur fin. Des relevés en 3D sont en train d’être effectués afin de restituer à la municipalité une maquette. Pour Christian Markiewicz, « cette crypte archéologique revêt un grand intérêt qui a pour vocation à accueillir le plus grand nombre possible ». Philippe Saurel compte bien mettre en avant ce lieu important du patrimoine de la ville.