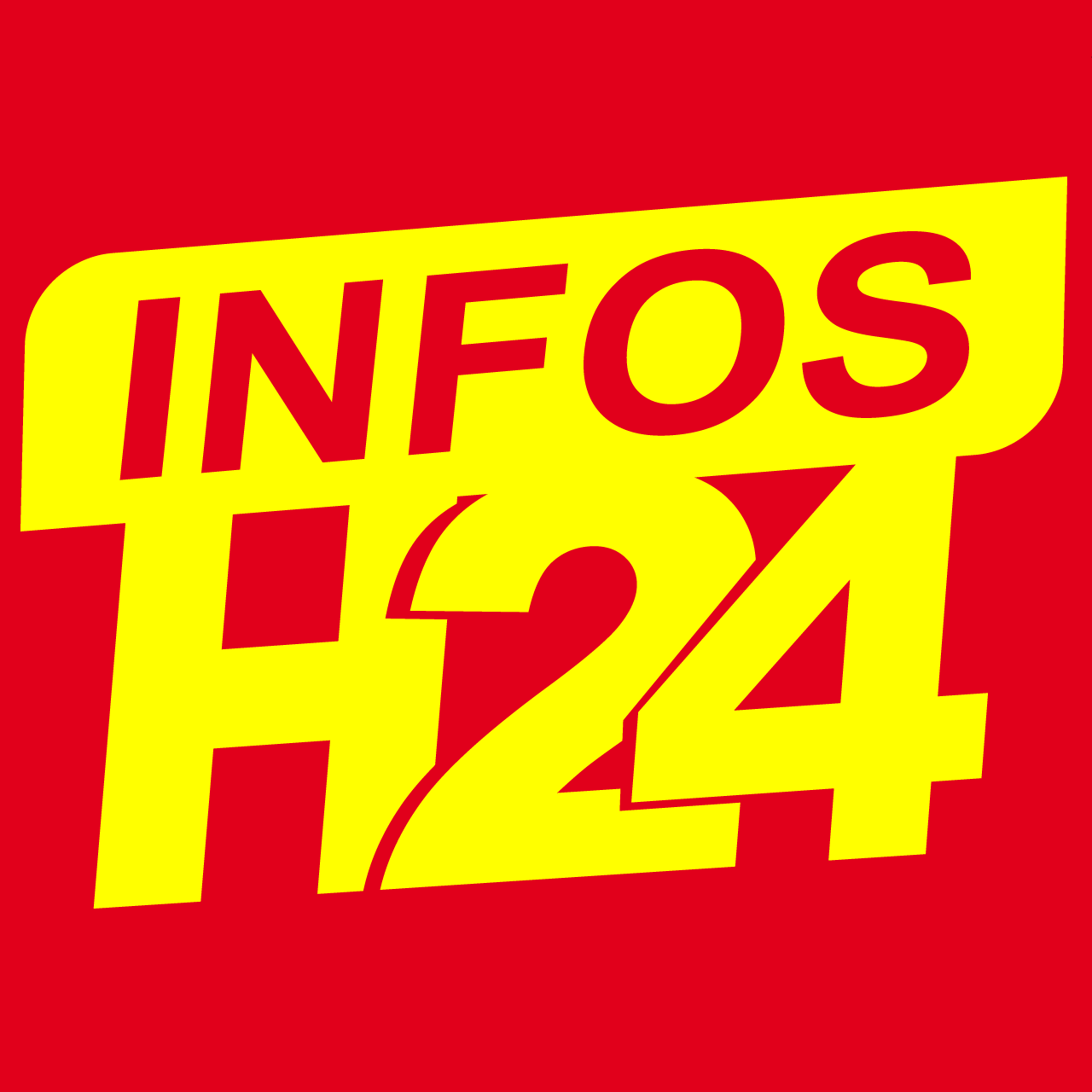JUSTICE. Lundi après-midi, dans un amphi de la faculté de droit, l’Université de Montpellier a signé une convention de partenariat avec le tribunal de grande instance -TGI- de Montpellier et le service pénitentiaire d’insertion et de probation -SPIP- de l’Hérault, afin d’accueillir des personnes condamnées à une peine de travail d’intérêt général, un TIG.
C’est une des premières universités à s’engager dans cette démarche solidaire et citoyenne. Répondre à un devoir d’exemplarité institué par la loi du 10 juin 1983, le travail d’intérêt général est une peine alternative à l’incarcération qui consiste en un travail non rémunéré au sein de la société civile : collectivités -mairies de Montpellier, de Castelnau-le-Lez, de Lattes etc.-, établissements publics, telles que les archives départementales, la SNCF, la DREAL, la gendarmerie, des associations comme l’AFPA, les Restaurants du cœur etc.
Une activité utile
« Le TIG permet de faire effectuer à la personne condamnée une activité utile pour la société, dans une démarche réparatrice et implique également la collectivité dans un dispositif de réinsertion sociale des personnes condamnées, notamment des plus jeunes, par son caractère formateur » a indiqué lundi Éric Maréchal, le président du tribunal de grande instance de Montpellier.
L’Université de Montpellier a répondu favorablement à la demande du procureur de la République d’ici, Christophe Barret, présent à la signature de cette convention et elle a souhaité s’engager dans ce dispositif au nom de sa responsabilité sociale. « Accompagner l’institution judiciaire en créant un partenariat profitable à tous répond également à son devoir d’exemplarité en tant que lieu de savoir et de pédagogie. Ouvrir des perspectives d’insertion sociale et professionnelle Les travaux proposés doivent être utiles, relever du secteur non marchand et ouvrir des perspectives d’insertion sociale et professionnelle à la personne condamnée », s’est ainsi félicité Philippe Augé, le président de l’Université de Montpellier.
478 condamnés « tigistes »
Un TIG permet par exemple d’améliorer l’environnement -entretien des espaces verts, le débroussaillage-, d’effectuer des travaux d’entretien et de manutention, de réparer les dégâts liés au vandalisme, d’entretenir ou rénover le patrimoine -restaurer un bâtiment historique-, d’effectuer des actes de solidarité -accompagnement de personnes handicapées, lecture pour des non-voyants-, de participer aux activités culturelles -accueil du public-, mais aussi d’accomplir des tâches administratives -classement, archivage, recherche documentaire-, d’éducation à la citoyenneté ou des travaux pédagogiques. Les TIG peuvent être collectifs.
À la date de ce lundi, 478 « tigistes » condamnés, dont 90% d’hommes effectuaient un travail d’intérêt général dans le ressort du TGI de Montpellier. Il s’agit d’hommes et de femmes qui purgent des peines essentiellement pour des délits routiers liés à l’alcool et aux stupéfiants et pour des violences légères. Des mineurs figurent parmi les « tigistes ».
Alternative à la prison
Cette convention a été signée par Philippe Augé, Éric Maréchal, Christophe Barret, Myriam Bouzat, vice-présidente du TGI de Montpellier en charge de la coordination de l’application des peines -JAP-, Christophe Cressot, directeur départemental du Service pénitentiaire d’insertion et de probation -SPIP- de l’Hérault.
Une convention inédite dans les universités d’ïle-de-France et de province scellée à Montpellier avec les institutions judiciaires d’ici qui jouent à fond la carte de l’alternative à la prison.
>> Pratique. Pour se renseigner : direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse : 05.62.30.58.09 http://www.justice.gouv.fr